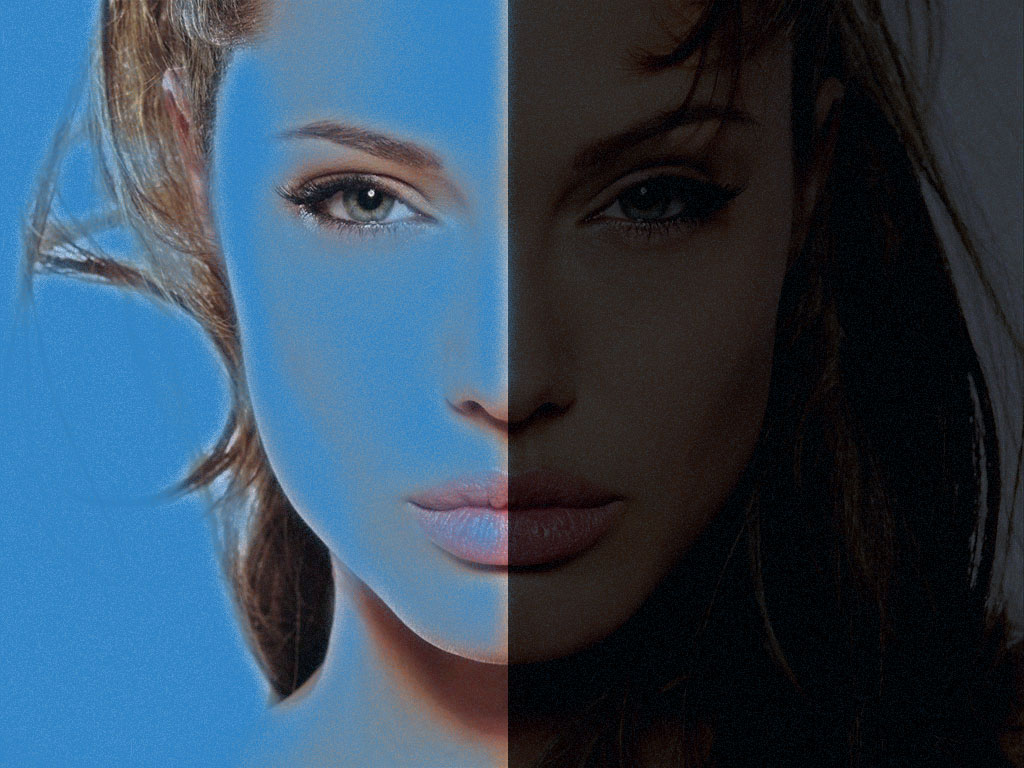
parodie picaresque*
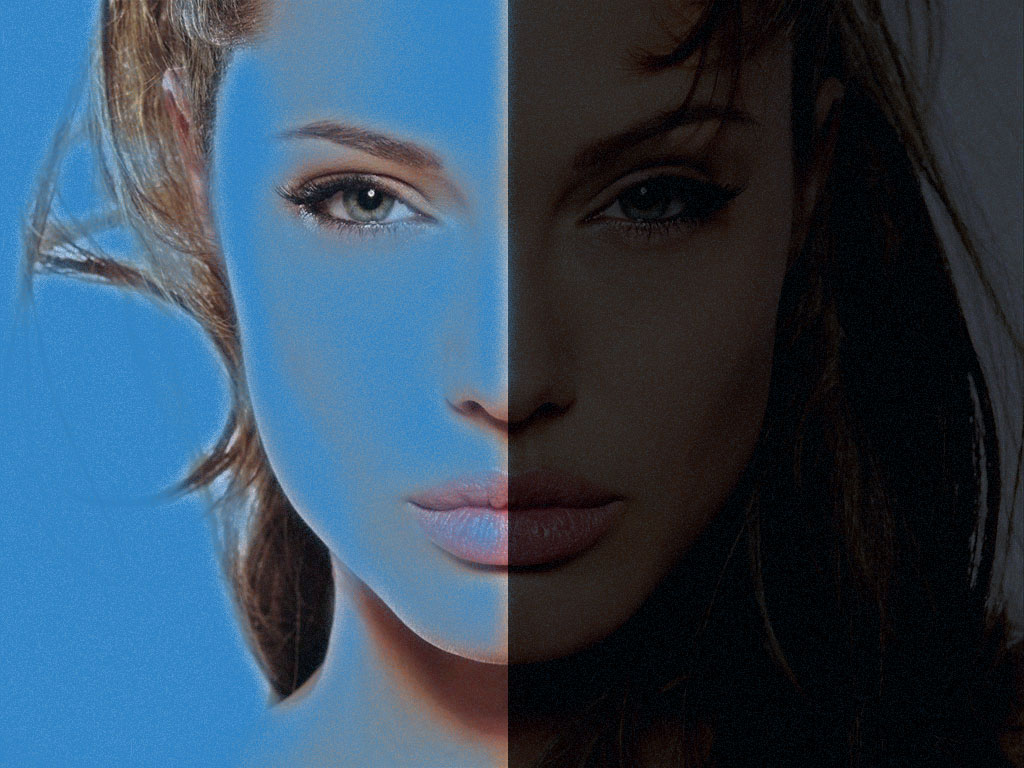
A Patty Diphusa et son créateur
Chapitre I
Dans lequel je résume mon enfance avant de jouer la fille de l'air
Je m'appelle Ella Lloq et ne suis pas fille à me cacher derrière mon petit doigt, qu'on dit joliment tourné, comme le reste de ma personne, au demeurant. On peut même dire que je n'ai pas froid aux yeux. Certains ajouteront que je n'ai froid nulle part. Mais, dans Barcelone la méditerranéenne, cela n'était-il pas plus facile qu'ailleurs ?
Je ne fais pas encore partie des égéries postmodernes patentées, mais j'en prends le chemin. Catalane, vous vous en doutez, bien que, à l'épeler, mon nom sonne différemment, mais ce n'est pas l'heure de démêler cet aspect mineur des choses... Nous y reviendrons, n'ayez crainte. Vu tout ce qui m'est arrivé depuis quatre ans à peine, le temps me semble venu de mettre un peu d'ordre dans ma courte vie et cela commence par ce récit.
Sans peur donc, mais pas sans reproche, je dois bien l'avouer, car depuis ma naissance, ma vie n'a été qu'embrouilles, avanies et démêlés avec l'autorité, familiale, scolaire ou religieuse.
Ma mère m'a enfantée dans le Barrio Chino, dans l'escalier étroit d'un claque, au fond d'une ruelle aux pavés usés. Quant à mon père, sans le secours de tests ADN, comment voulez-vous que l'on sache lequel des milliers de marins en goguette de par la ville m'a cédé la moitié de ses chromosomes ?
Ma mère, Adèle Montretout, penche pour un beau marin chilien avec lequel elle s'est laissé aller à prendre son pied, contre toutes les règles de la profession. Mais ce n'est qu'une intuition, rien de plus.
Moi, Ella Lloq - le protecteur local de ma mère m'a reconnue dans un de ses rares jours de bonté - j'ai donc grandi chez les demoiselles de la rue d'Avignon, entre les odeurs mélangées du patchouli et du benjoin, du permanganate et de l'eau de javel, qui tentaient vainement de cacher celles, plus essentielles, de l'établissement.
Mon père nourricier - je devrais plutôt dire dépensier, car il ne faisait que claquer l'argent que ma mère gagnait à la sueur de son.... front - était un homme à principes. Pour lui, il y avait trois sortes de femmes : celles qu'on met sur le trottoir pour gagner sa vie et qu'il faut mener à la dure, sous peine de voir péricliter son capital ; les épouses et les filles qu'il faut garder sous clé tant que faire se peut et sa mère, qui était le parangon de la sainteté. La mienne, pour sa part, jouissait - enfin, le terme n'est pas très bien choisi - d'un statut intermédiaire qui pouvait se résumer en une phrase : "des clients, autant que possible, des amants, t'as pas intérêt !"
Ainsi donc, en vertu de ce qui précède et avec l'assentiment de maman, qui était bien trop bonne pâte, pour cela comme pour le reste, ce demi-sel avait mis la fille de sa gagneuse en pension dès son plus jeune âge chez les bonnes sœurs de la Visitation, aux confins de la ville, du côté du Tibidabo, pour asseoir les bases d'une éducation qu'il entendait ensuite parfaire à sa manière.
Ce fut le début de ma carrière aventureuse.
Mon premier coup d'éclat consista à organiser nuitamment avec mes compagnes de dortoir une razzia dans les cuisines du collège. Ayant dérobé les clés de l'intendante, qui ronflait comme un sonneur dans sa chambrette, nous pillâmes armoires et frigos, sans compter la réserve de bouteilles pour les jours de réception de Monseigneur l'Évêque. On nous retrouva, au petit matin, ivres mortes, barbouillées de confiture, de chocolat, sardines à l'huile et autres conserves délectables.
Moyennant un don substantiel - que ma mère dut rembourser à son julot en redoublant d'activité - les sœurs consentirent à garder la meneuse de ce charivari nocturne, mais je fus cependant privée de sorties durant tout un trimestre.
Sur mon carnet de correspondance, à la fin de cette première année de pensionnat, il était écrit, à l'encre violette, de cette écriture avec pleins et déliés tombée aujourd'hui dans les oubliettes de la pédagogie : "A des dons pour tout ce qui n'est pas dans le règlement et de graves lacunes pour tout ce qui est dedans". Avec quatre ou cinq points d'exclamation.
Finalement, je devais passer huit ans entre ces hauts murs, huit longues années entrecoupées de renvois passagers et de punitions innombrables.
J'en ai gardé un vernis de religion, pour les jours sombres, un certain goût pour la littérature et suffisamment d'orthographe et de syntaxe pour rédiger ceci sans tracas.
C'est dans ma quinzième année qu'eut lieu mon renvoi définitif, avec pertes et fracas.
Pour ce temps-là, la petite effrontée que j'étais était devenue une jeune fille, en tous points formée, et l'uniforme strict de l'établissement ne réussissait plus à cacher l'évidence : je provoquais la concupiscence, comme d'autres la pitié ou la charité. Personne n'échappait à l'emprise de ma beauté singulière : ni mes camarades, ni les sœurs ni surtout l'aumônier qui m'entendait en confession tous les vendredis.
Il advint ce qui devait advenir : la main de l'aumônier s'égara et je trouvai cela plutôt plaisant. Je découvris bientôt que tous les cierges n'étaient pas de cire et qu'il y avait bien des manières de monter au ciel. Bref, je me perdis pour la religion et provoquai ainsi mon entrée dans le monde.
Mon beau-père qui estimait m'avoir munie de tous les viatiques nécessaires à une vie de pécheresse, entreprit aussitôt de me mettre à pied d'œuvre, mais je n'entendais pas avoir quitté une institution rigoriste pour entrer au bordel, fût-il familial. C'est pourquoi je fis mon baluchon dès le second soir, sans attendre que le maquereau de ma mère me mette la main au panier et le marché en main.
Dans l'intervalle, je m'étais donné un look à mi-chemin entre celui d'Alaska et de Catherine Ringer, mes idoles de l'époque en matière de rébellion musicale. On ne pouvait donc pas me rater. Direction l'autoroute et la movida madrilène. On était en 1986.
J'avais à peine levé le pouce et cambré le postérieur sur le bord de l'A2 qu'un trente-huit tonnes qui sortait de Mercabarna* s'arrêtait pour me faire un brin de conduite.
II
Où je raconte mes premiers pas madrilènes et ma rencontre avec une jeune fleuriste
La radio du gros cul dévidait le refrain de "No es pecado" à mi-volume. Cela me parut être un signe :
Más allá del bien y el mal
no espero salvarme
Entre el vicio y la virtud
no puedo escaparme
ésta fue mi perdición
y perdida estoy sin remisión*
Ce mélange de culpabilité, d'autodérision et ce sentiment d'avoir atteint un point de non-retour, c'était exactement mon état d'esprit.
Six heures plus tard, après avoir payé en nature mon écot à un chauffeur qui n'en demandait pas tant, je débarquais au marché de gros de Madrid à l'heure du laitier, un peu endolorie, mais bien décidée à faire mon trou dans la capitale de la "Movida".
À Madrid, comme à Barcelone, le monde des halles était encore essentiellement masculin et machiste autant que faire se peut. Sous un déluge de "piropos" ouvertement obscènes, je traversai, tête haute et regard de défi, la halle aux fruits et légumes, mon petit bagage d'osier à la main. Il faut dire que ma minijupe de skaï noir, mon petit haut fuchsia décolleté, mes chaussures à talons compensés et mes cheveux au carré d'un roux flamboyant, n'étaient pas faits pour apaiser les passions.
Je m'apprêtais à poursuivre mon chemin dans la halle aux viandes, quand une marchande de fleurs, qui finissait d'organiser ses bouquets sur son étal, me tira par la manche :
— N'y va pas. Les bouchers, c'est les pires. Allez viens, je te paye un café.
Avec ses mèches multicolores, coiffées en pétard sur une bouille parsemée de tâches de son, la jeune fleuriste faisait honneur à sa profession. Elle portait une salopette qu'on aurait dite empruntée à la Croix Rouge, sur le déjà célèbre T-shirt blanc de Mango avec des Doc Martens vert pomme. Son look me plut instantanément.
— Salut. C'est cool. Merci.
— Allez, viens.
Cette rencontre allait s'avérer décisive, mais je l'ignorais encore.
Maitena m'entraîna à l'arrière de son stand. Une cafetière électrique achevait de passer six tasses d'un café dont l'arôme couvrait presque totalement les senteurs florales de la boutique.
— Je ne devrais pas faire de café ici, ce n'est pas bon pour le commerce, mais je ne peux pas m'en empêcher et celui des distributeurs, j'te raconte pas.
Nous nous posâmes sur deux pliants. Maitena scruta quelques instants mon visage, tandis que je me réchauffais les mains à la chaleur de ma tasse.
— Ça me regarde pas, mais tu sais où aller ? Tu vas coucher où ce soir ?
Je lui rendis son regard scrutateur et finalement dis :
— J'ai un cousin qui habite par ici, seulement je ne sais pas si...
— Pas la peine de me raconter des craques, tu sais. Moi aussi, j'ai fichu le camp de chez moi, il y a deux ans.
Mon regard s'éclaira un instant, mais ma courte expérience m'avait déjà appris que dans la vie c'est généralement donnant donnant et je répondis durement :
— Qu'est-ce que tu me veux ? J'te préviens, j'aime pas les filles.
— Qu'est-ce que t'en sais ? T'as déjà essayé ? Il ne faut jamais dire fontaine... tu connais ?
— C'est pas tes oignons.
— OK, d'accord. je retire ce que j'ai dit. Tu veux encore du café, Machine ?
— Ella. Je m'appelle Ella Lloq.
— Moi, c'est Maitena Bous.
Nous nous regardâmes avant d'entrechoquer nos tasses.
— Bienvenue à Madrid, Ella Lloq.
— Merci, Maitena Bous.
Puis nous partîmes d'un grand éclat de rire.
— Tu veux faire quoi, ici à Madrid ?
— Je sais pas, de la danse, de la musique, de la pub, du ciné, faire la fête, m'éclater, quoi.
— Eh ben, en voilà un programme ! Et tu sais faire quoi, de tout ça ?
— À part la fête, rien.
— Ça promet. Et puis, t'as quel âge, d'abord ?
— Ça, ma vieille, c'est top secret.
— Ouais, je vois, l'âge de faire des conneries, mais pas de les assumer, hein ?
Maitena me regardait les yeux à demi-fermés.
— Remarque, avec le physique que t'as, tu pourrais faire n'importe quoi, c'est clair, t'es vachement belle. Écoute, j'ai peut-être un plan. Le soir, je fréquente un petits groupe d'étudiants et d'artistes en herbe. Il y en a deux qui sont peintres et cherchent des modèles. Bon, bien sûr, c'est un peu olé olé, mais faut ce qu'il faut, hein ? Si tu veux, je te les fais rencontrer ce soir.
Je hochai la tête avec vigueur, tout en avalant le reste de ma tasse de café. La vie d'artiste et de bohème, c'était mon rêve. La peinture, pour moi, c'était les tableaux sombres et poussiéreux de saints et de vierges chez les bonnes sœurs, mais si ça pouvait me nourrir, au moins dans les premiers temps... Alors, dans un geste spontané, je claquai deux bises sonores sur les joues constellées de son de Maitena.
— Eh bien, tu vois, quand tu veux, me dit celle-ci, des lumières dans les yeux.
Chapitre III
Dans lequel je découvre le monde de la movida et y trouve un premier emploi
La Ville, ranimée par Tierno Galván,* bruissait comme jamais.
Quand Maitena et moi sortîmes du Métro à la station Tribunal dans Malasaña, il n'était pas encore vingt-deux heures et les madrilènes sacrifiaient avec ardeur au "copeo", avant ou après le "paseíto" d'usage. Les bars débordaient sur les trottoirs, les sirènes des ambulances trouaient un fond sonore d'avertisseurs, de publicités agressives et de musiques tonitruantes, sorties de véhicules aux vitres baissées ou de bars à musique, toutes portes ouvertes. Les rideaux de fer abaissés des boutiques de vêtements de la zone étaient constellés de graffiti la plupart du temps obscènes, souvent politiques et parfois poétiques. Les tenues les plus extravagantes passaient ici inaperçues, tellement elles étaient nombreuses. Aussi personne ne se retourna-t-il sur nous, bras dessus dessous comme deux vieilles copines.
Nous nous dirigeâmes vers la rue Velarde. Au numéro 18, l'enseigne lumineuse de la Vía Láctea clignotait dans la nuit tombante. C'était là que la petite bande que fréquentait Maitena se réunissait, sans savoir que tout un tas de futures célébrités s'y côtoyaient. Après quelques "vinitos" et les "tapas" d'usage, nous irions peut-être au Penta derrière sa façade bleu nuit, rue de la Palma, ou encore au Sol, rue des Jardins, autour de sa curieuse scène en demi-cercle, avant de finir la soirée au Rock-Ola, la discothèque la plus prisée du moment, à quelques pâtés de là.
J'espérais, sans le dire, y apercevoir mon idole, Olvido Gara, que je ne connaissais encore que sous son nom de scène d'Alaska. C'est à travers son personnage de sorcière-présentatrice du fameux programme pour jeunes "la Bola de Cristal", lancé deux ans auparavant, que j'avais découvert la chanteuse de Kaka de Luxe. Depuis qu'elle s'était fait une crête à la manière de certains indiens Shoshones, toute la jeunesse rebelle d'Espagne imitait son look, guettant chacune de ses apparitions comme le "nec plus ultra" à suivre, imiter, dépasser si possible. Bientôt, combien de filles adopteraient la crinière flamboyante qu'elle mettrait à la mode ? Je tremblais d'impatience de la voir, la toucher, la rencontrer.
Hélas, au Rock-Ola, Alaska et Dinarama, son nouveau groupe, n'étaient pas au programme du jour, mais venu de la maison d'à côté, Costus occupait une table avec Fabio MacNamara et Blanca Sánchez, sortie de sa galerie voisine pour retrouver ses protégés.
Ce soir-là Fabio, qui cultivait son look androgyne, était maquillé comme une voiture volée et arborait un pantalon moule-b... genre Henri III, la culotte bouffante en moins, et de magnifiques escarpins rouges à talons aiguilles de dix bons centimètres.
Blanca, pour sa part, portait une jupe droite de cuir noir sur des collants brique, un pull à larges rayures horizontales mauves et noires et pour couronner l'ensemble une veste noire et blanche à petits damiers !
Juan y Enrique, les deux peintres qui signaient Costus, crinière brune et visage émacié pour l'un, gueule d'ange et cheveux peroxydés pour l'autre, étaient vêtus plus sobrement, jean, boots et T-shirts des Sex Pistols.
Sur leur table, des verres, une bouteille de gin, une autre de cognac, des paquets de cigarettes, un cendrier plein à ras-bord et dans les regards qui se tournèrent vers nous à nôtre entrée, des pupilles passablement dilatées.
Maitena, connaissait tout le groupe, pour une excellente raison. Dans les camions qui chaque nuit arrivaient à Mercamadrid, transitaient des marchandises qui pour être consommables n'en étaient pas moins interdites : marijuana, cannabis, héroïne, LSD. Herbe, résine, poudre et cachets voyageaient parmi les cartons de viande, fruits et légumes.
Et la toute jeune démocratie espagnole ne savait pas encore quelle politique adopter face à un phénomène qui prenait chaque jour davantage d'ampleur : à Madrid, on trouvait de la drogue partout, presque en vente libre.
Aussi, Maitena, arrondissait-elle sans états d'âme ses fins de mois avec ce commerce annexe dont la filière était structurée exactement comme le marché des halles : gros, demi-gros, détail. Elle, revendait au détail, mais en tirait quand même plusieurs milliers de pesetas par mois.
Dans le milieu de la "movida", tout le monde touchait à tout ou presque : nuits et jours s'enchaînaient dans un délire de création, de fêtes orgiaques improvisées ou savamment calculées, de concerts, expositions, happenings de toutes sortes... Madrid avait dépassé Londres.
J'étais suspendue aux lèvres de Maitena et buvais toutes ses paroles comme du petit lait : c'était là que je voulais être et j'y étais. À toi de jouer maintenant, ma vieille, me dis-je, en prenant place avec ma nouvelle amie à la table où on venait de nous inviter à nous asseoir.
Maitena prit la parole la première, en posant ses fesses sur un coin de banquette libre :
— Salut, je vous présente Ella, une copine.
Tous les hommes du groupe me dévisagèrent, mais d'une manière si différente de ce à quoi j'étais habituée que je sus instantanément qu'ils étaient gays. Peut-être bi, pour l'un d'entre eux, tout de même. Quant à la fille, elle aurait pu être ma mère..., mais parut impressionnée, cependant.
— Et d'où est-ce qu'elle nous arrive, Ella ? lança Enrique avec un regard approbateur.
— De Barcelone et je voudrais travailler dans le spectacle, la pub ou des trucs comme ça.
— Rien que ça. On ne doute de rien, à ce que je vois. Eh bien, assieds-toi et bois un verre en attendant, lança Fabio en faisant un joli rond de fumée de sa bouche rouge cramoisi.
— Merci. Avec plaisir.
Deux heures et quelques verres plus tard, alors que la salle enfumée se vidait à peine et que Fabio venait d'annoncer à voix basse qu'il descendait aux toilettes, j'avais vu Maitena le suivre aussitôt. La jeune fleuriste était remontée quelques minutes plus tard, mais le travesti bien après, le regard métallique et les gestes lents. Dans l'intervalle, Enrique en avait profité pour se rapprocher de moi et venait de me proposer de poser pour lui et Juan. J'avais accepté, sans réfléchir, avec l'enthousiasme de la jeunesse et toute la fraîcheur de mes illusions.
Chapitre IV
Où, pour un temps, je vire ma cuti
Dans les semaines qui suivirent, j'allais passer de longues heures dans des poses éreintantes, en Ève triomphante, en petites tenues tentantes, ou accoutrée de déguisements improbables, tout droit sortis de l'imagination débridée des deux peintres. La maison de Costus était un des hauts lieux de création de la Movida. S'y croisaient Pedro Almodóvar, ses muses, sa petite cour de génie naissant et d'autres artistes en devenir. C'est ainsi que je vis sortir des écrans de télévision ou de cinéma où je les croyais confinés, Carmen Maura, Antonio Banderas, Rossy de Palma... et bien d'autres. Ah ! Antonio Banderas ! Hélas, il était déjà en mains. Une bombasse qui le couvait des yeux comme le lait sur le feu. Je découvris surtout qu'ils étaient pétris de chair et de sang tout comme moi, cachaient leurs angoisses sous des dehors provocateurs et brûlaient leur vie de peur de la perdre.
Ma jeunesse, mon éclat, mon statut d'ingénue perverse - car Maitena, qui ne savait pas tenir sa langue, s'était empressée de partager mes petits secrets - firent bientôt de moi le centre d'attraction de tous les regards et l'objet de bien des convoitises.
La grande beauté est intimidante pour beaucoup d'hommes, à ce qu'on dit. Et je connus l'étonnement d'être "entreprise" d'abord par une femme, un soir de vernissage, où le "cava" et les volutes enivrantes n'avaient pas manqué.
C'était devant les miroirs des toilettes. Ma voisine était une brune aux cheveux courts, plus âgée que moi - vingt-huit, trente ans peut-être - dont le look rappelait celui de Ana Torroja, la chanteuse de Mecano. Si j'avais bien perçu ses œillades insistantes à plusieurs reprises durant la soirée, habituée aux regards d'envie des femmes comme à ceux de désir des hommes, je n'y avais pas prêté attention outre mesure. Mais là...
La fille, les bras tendus appuyés sur le lavabo, les yeux brillants et les pointes des seins dressés sous la tunique transparente, tourna soudain la tête vers moi, tandis que je me recoiffais et, tendant ses lèvres, me jeta :
— S'il te plaît, embrasse-moi.
Je n'eus pas le temps de balbutier un refus que la fille m'avait plaquée contre les carreaux de faïence du mur et me prenait la bouche. Je tentai d'abord de la repousser, mais l'autre savait y faire ; je sentis bientôt mes défenses faiblir et le désir titiller mes entrailles. Mes lèvres se firent plus douces sous les assauts donnés. Bientôt, je rendais les armes et toutes deux nous allâmes nous enfermer dans un des box des WC.
Elle s'appelait Lola, était jalouse comme une tigresse et allait m'en faire voir de toutes les couleurs.
Elle aurait voulu que je porte au poignet un bracelet clouté, relié à une chaînette qui, en public, m'aurait enchaînée à elle pour signifier mon appartenance et ma soumission. Si, dans le milieu interlope de la "movida" cela n'aurait sans doute pas été commenté bien longtemps, dans les rues commerçantes de Madrid, il en allait encore autrement. Évidemment, c'est à l'enchaînée que le machisme ibérique s'en prenait. Après avoir essuyé une ou deux fois les pires injures que j'eus entendues de ma vie, je déclarai à ma maîtresse :
— Plus jamais ça ou je te quitte !
Hélas, la jalousie de Lola était maladive : le moindre regard, le plus petit geste posaient problème, et devenaient source de scènes épuisantes. Quelques semaines passèrent ainsi. Puis, convaincue que je n'étais pas vraiment homosexuelle en dépit de nos réconciliations passionnelles sur l'oreiller, je décidai de quitter ces bras étouffants pour ceux d'un homme, sans savoir encore lequel. Je pensais que, déçue de n'avoir pas affaire à une lesbienne pure et dure, Lola porterait alors ses yeux sur une Sapho plus convaincante et me laisserait tranquille.
Comme la plupart des hommes, Maitena, pour sa part, considérait que j'étais inaccessible et semblait avoir renoncé à être plus que mon amie. Néanmoins, par une double jalousie naissante, elle n'avait pas du tout apprécié que je cède aux avances de Lola, qui était tout à fait son genre et plus à sa portée, pensait-elle. Il y eut donc comme un froid entre nous pendant cette période.
Moi, qui avais déménagé de chez Maitena pour aller me lover dans les bras de Lola, je me retrouvai donc à la rue, avec mes maigres bagages, le jour où je partis en claquant la porte après une dernière scène mélodramatique que le maître du kitsch lui-même n'aurait pas reniée.
Chapitre V
Dans lequel je trouve à la fois à me loger et à arrondir mes fins de mois
En posant pour Costus, j'avais gagné assez d'argent pour louer une chambre dans le quartier, car leur notoriété croissant, Enrique Naya et Juan Carrero gagnaient déjà bien leur vie. J'aurais pu trouver à meilleur marché un peu plus loin, mais je ne voulais pas m'éloigner de mon lieu de travail ni de mes nouvelles fréquentations, même si la perspective de croiser Lola me donnait un peu la chair de poule.
Je trichai sur mon âge, bien entendu, passai sous silence la nature exacte de mon travail, mis en avant mes études chez les bonnes sœurs, sans préciser lesquelles de peur qu'on ne s'enquît auprès d'elles de ma réputation, tirai ma jupe sur mes genoux ostensiblement et tins les yeux baissés durant tout l'entretien, dès que je sus à quoi m'en tenir sur mes futurs propriétaires.
Le mari, calvitie prononcée et moustache impeccablement taillée, cachait un intérêt évident pour mes courbes derrière des lunettes fumées. La femme, qui avait dû être belle, torturait ses mains comme en proie à une sourde inquiétude.
— Ce sera cinq cents pesetas par mois, payables d'avance, en espèces, s'il vous plaît.
— Naturellement.
Les cinq billets neufs de cent pesetas que je posai aussitôt sur la table basse du salon finirent d'emporter la décision. Marché conclu, d'une poignée de mains, sans plus de formalités. Et pour cause : ces braves gens étaient eux-mêmes locataires et la sous-location interdite. Heureusement, le propriétaire vivait aux Amériques et son homme d'affaires se contentait d'encaisser les loyers rubis sur l'ongle.
C'est donc chez ce couple de personnes âgées - lui, un ancien militaire, elle, n'avait jamais travaillé - que j'emménageai, dans un immeuble cossu de la rue Fuencarral, au sixième étage (avec ascenseur). Ma chambre donnait sur le "patio de luces", mais était spacieuse et relativement claire, meublée avec goût, même si ce n'était pas le mien, dans un style que j'imaginais remonter aux années trente.
Je commençai par ôter le crucifix qui surplombait le lit pour le cacher au fond d'un des tiroirs de la commode. Puis je testai les ressorts du sommier et du matelas avant de m'allonger dessus, bras et jambes écartés, histoire de mieux en prendre possession.
Soudain, je me redressai pour aller en reconnaissance dans le couloir où on m'avait mentionné, sans plus de précisions, que se trouvaient la salle de bains et les toilettes. C'est que, dans la plupart des logements, "el baño", comme on dit, réunit les deux fonctions, ce qui n'est pas très pratique quand on vit à plusieurs dans un même appartement. Par chance, les WC étaient au fond du couloir et la salle de bains à côté des deux chambres restantes. Il me faudrait donc partager cet espace.
Il y trônait une baignoire profonde, à pieds de bronze, avec quand même une douchette, mais pas de rideau. Le lavabo était assorti. Le chrome des robinets s'était effacé à l'usage et le laiton apparaissait ici et là. La porte comportait un oculus de verre dépoli.
J'imaginai bientôt tout le parti que je pouvais tirer de cette disposition des lieux.
Dès mon installation chez les Suarez, j'avais su qu'il ne serait pas difficile de transformer Monsieur en voyeur, voire davantage. Le tout, c'était de ne pas éveiller les soupçons de Madame, sous peine de me retrouver à nouveau à la rue.
Je commençai par noter les horaires des allées et venues du couple. Monsieur était matinal et bien qu'ils fissent chambre à part, portait le petit déjeuner au lit à son épouse, comme un métronome, à huit heures chaque matin. Celle-ci ne sortait de sa chambre que vers dix heures, se préparait et vers onze heures allait faire son marché. Monsieur, de son côté, rasé de frais et parfumé à l'eau de Cologne ou au Vétiver, passait un costume, prenait sa canne et son chapeau et s'en allait acheter le journal au kiosque, faire son tour de quartier, flâner au parc avant de terminer la matinée devant un vermouth et des olives au café Impérial. Vers une heure, il rentrait au logis où il entendait que le déjeuner fût prêt. Et il l'était, j'en étais sûre, bien que j'eusse décliné l'offre de prendre mes repas avec mes logeurs, contre une rétribution qui me parut exagérée.
Monsieur passait à la salle de bains, pendant que Madame prenait son petit déjeuner. J'estimai donc qu'il me fallait procéder à mes ablutions vers huit heures - c'était tôt, mais qui veut la fin s'en donne les moyens - afin que Monsieur me vît en train de me doucher au moment opportun.
Les premiers jours, je fermai consciencieusement à clé la salle de bains et me gardai bien de me retourner sous la douche. J'étais certaine que le vieux cochon restait scotché devant le spectacle d'ombres chinoises que je lui donnais gratis. Pas besoin d'autre intervention. Je savais qu'il allait fébrilement tourner la poignée pour vérifier si je m'étais enfermée ou pas.
Deux semaines passèrent ainsi.
Puis, estimant que je l'avais assez lanterné et qu'il devait être à point, le jour suivant j'omis de tourner la clé.
Que croyez-vous qu'il arriva ?
Comme chaque matin, Monsieur Suarez, en robe de chambre, se présenta sur la pointe des pieds devant la salle de bains pendant que je me lavais et, comme chaque matin, tenta d'ouvrir la porte sans bruit. Et ce jour-là elle s'ouvrit, le laissant ébahi, devant moi qui lui fis aussitôt face, en tentant de cacher ma nudité de mes mains, un peu, mais pas trop.
Monsieur Suarez s'excusa, je dis que c'était ma faute, j'avais oublié de fermer, puis je lui demandai de bien vouloir me donner mon peignoir, accroché à la patère, avant de dévoiler mon intimité un bref instant en le passant devant lui.
Pour ce temps-là, Monsieur Suarez avait les yeux comme des soucoupes et ne pouvait les détacher de mon... et de mes... ; je décidai donc de pousser mon avantage.
— Monsieur Suarez, vous n'avez pas l'air bien. Tenez, asseyez-vous un instant sur le tabouret, voulez- vous ?
Il s'assit, révélant une érection de belle taille, et m'agenouillant devant lui, je dis :
— Laissez-moi faire, je vais vous arranger ça, Monsieur Suarez, mais chuut, n'est-ce pas ?
Et je remerciai intérieurement le chapelain du pensionnat de m'avoir montré la marche à suivre.
Chapitre VI
Où commence pour moi le temps des épreuves
Toute bonne action méritant récompense, c'est ainsi que je repris bientôt, grâce à Monsieur, le loyer que je versais chaque mois à Madame.
Il aurait voulu davantage. Me mettre dans son lit.
— Vous n'y songez pas, Monsieur Suarez. À votre âge ! Vous voulez risquer une attaque ? Et puis, ce ne serait pas convenable. Je veux bien soulager vos ardeurs de temps à autre, mais rien de plus.
Il se résigna au statu quo.
Si mes soucis d'argent semblaient réglés pour un temps, restait cependant un autre problème : qui allait s'occuper de mes ardeurs à moi ?
Les hommes que je croisais me regardaient avec des yeux de merlan frit, mais en restaient là, comme tétanisés, ceux avec qui je travaillais étaient plus à voile qu'à vapeur, les femmes, j'avais déjà donné, il devenait urgent de passer à l'attaque, le massage clitoridien cela va un temps, mais ma nature généreuse n'aurait su s'en contenter.
Le Rock-Ola m'offrait un terrain de chasse tout trouvé, mais le problème était de trier le bon grain de l'ivraie. Je n'entendais pas rester au bas de l'échelle sociale, fût-elle artistique, toute ma jeunesse. Et aspirais donc à joindre l'utile à l'agréable.
La fréquentation des artistes de la "movida" m'avait appris que si quelques-uns d'entre eux subvenaient correctement à leurs besoins, la plupart tiraient plutôt le diable par la queue. Seuls les imprésarios, agents, producteurs des premiers pouvaient mener la belle vie et ne s'en privaient pas.
Je me mis donc à repérer parmi cette faune restreinte les amateurs de havanes, les porteurs de costumes Armani, de montres Rolex et de chaussures italiennes, les titulaires de cartes Visa Premier. Avec deux premières exigences qui me parurent minimales : célibataire et pas plus de quarante-cinq ans ! Je savais par ma mère que les hommes mariés quittent très rarement leur femme pour leur maîtresse et ne voulais pas coucher avec quelqu'un qui aurait pu être mon grand-père !
Ces gens-là, habitués à négocier toutes sortes de marchés, n'avaient aucune appréhension de la beauté, car ils étaient persuadés que leur argent pouvait tout acheter. Et je pensais : "Oui, même moi, mais pas à n'importe quelles conditions".
Plusieurs, qui avaient franchi la première sélection, se virent donc rembarrer non pas pour absence de moyens, mais pour défaut d'hygiène, excès d'embonpoint, langage ordurier... j'en passe et des pires, en dépit de leur portefeuille garni et de leurs offres alléchantes.
Oui, mais l'on commença à jaser. Et bientôt le bruit courut les soirées que si personne ne trouvait grâce à mes yeux, c'était que, pour une raison secrète, je ne voulais pas m'engager : étais-je touchée par cette maladie nouvelle et mystérieuse, qui d'un cas il y a cinq ans, avait déjà causé plus d'une centaine de décès cette année. On disait que Enrique, pour qui je posais... en était atteint.
C'est ainsi que je me retrouvai victime d'un second ostracisme, aussi injustifié que le premier, mais aux conséquences plus dramatiques.
En effet, presque du jour au lendemain , on s'écarta de moi, ou bien mon interlocuteur filait se laver les mains au lavabo dès que j'avais le dos tourné.
Le seul bon côté de la chose fut que je rentrai en grâce auprès de Maitena. Ayant accompagné jusqu'à la fin un de ses amis toxicos contaminé par une seringue, elle savait de la maladie tout ce qu'on pouvait en savoir et connaissait le vide injuste que le VIH provoquait autour de chaque malade, réel ou supposé. Bientôt, elle fut la seule à me fréquenter.
Il ne se passait pas de semaine sans que la communauté artistique de la Movida n'apprenne que tel ou tel était malade, terrassé par une pneumonie adventice, ou couvert de bubons pustuleux, ou encore mourant dans un service d'hôpital gardé comme un bunker. Les homosexuels étaient les plus affectés. Je crus un temps à une malédiction ; les esprits réactionnaires et bien-pensants parlèrent carrément de punition.
Maitena, épargnée dans sa chair, ne baisait plus qu'avec des filles ou alors avec des capotes et vraiment à la dernière extrémité. Je me résignai pour un temps à l'abstinence.
Ce n'était pas une vie. Le sexe, qui, pour moi, en était indissociable, devenait tabou. Il fallait se méfier de tout et de chacun. Ou alors tomber sur un puceau et se le garder. Mais comment être sûre ?
Sortir couvert, disait la publicité, ou ne pas sortir. Les garçons avaient horreur de ça, et moi aussi. Les filles du quartier qui acceptaient de le faire sans protection, virent leur clientèle augmenter de cinquante pour cent.
Mais, lorsque les rangs des ces inconscientes commencèrent à s'éclaircir, il fallut bien se rendre à l'évidence : à présent, tout le monde était touché, hétéros, homos, sans distinction d'identité ni de pratiques sexuelles. Le temps était venu de prendre d'autres habitudes.
Désormais, dans mon sac j'avais toujours une boite de Durex pour Lui. Mais Lui se faisait attendre. Alors, j'ai eu recours à quelques extras. "Il faut bien que le corps exulte "comme dit ma mère qui adore cette chanson de Brel, alors qu'elle ne comprend pas la moitié des paroles ! Mais avec cette trouille vissée au ventre, que dans le feu de l'action il oublie de se protéger, que la capote soit percée, comment prendre son pied ? Sans compter les trucs que tu ne peux plus faire. C'était des coups à devenir frigide.
Enfin, l'arrivée de l'AZT avec la mise en vente du Retrovir redonna un semblant d'espoir aux séropos. Je dis un semblant parce que cela ne changeait pas réellement le problème, si tu déclarais la maladie, tu savais que tu allais mourir moins vite, c'était tout. Et en avalant je ne sais quelle quantité de cachets par jour.
Moi, par chance, je ne suis pas devenue séropositive. Mes tests HIV ont toujours été négatifs. Je touche du bois.
Chapitre VII
Dans lequel mon avenir se dessine enfin
Par l'intermédiaire de Costus et de Fabio Mac Namara, j'avais réussi à obtenir un rôle de figurante dans "La loi du désir", le dernier film d'Almodóvar. Si vous regardez le générique jusqu'à la fin, vous verrez défiler mon nom ; par contre ne me cherchez pas à l'image, ma scène a été coupée de la version distribuée !
J'étais sur une liste. On m'a appelée par la suite pour d'autres figurations. Jusqu'à ce que Carmen Maura me remarque dans la masse des figurants sur le tournage de "Femmes au bord de la crise de nerfs" et demande à Pedro de me donner ma chance et un petit rôle. Il m'a fait tourner un bout d'essai et j'ai été prise. Voilà comment j'ai réellement débuté au cinéma, moins d'un an après mon arrivée à Madrid.
Qu'est-ce qu'il m'a donné comme rôle ? Une petite secrétaire, y'a pas de quoi pavoiser, je sais. Avec sa réputation et la mienne, j'avais trop peur qu'il me donne un rôle de p..., alors je me suis estimée contente de ce début.
Le succès extraordinaire du film a fait le reste. Après, quand tu dis, "J'ai travaillé avec Pedro Almodóvar sur Mujeres..." tout de suite, les portes s'ouvrent plus facilement. Parce que tout le monde sait qu'il a le "feeling" pour les personnages féminins.
La suite ? C'est une autre histoire. Je la raconterai un jour, peut-être, pas ce soir. Je vous en ai déjà beaucoup dit, non ?
Ah oui, je vous avais promis, avant de vous quitter, de revenir sur cette histoire de nom qui fait rire tous les Français. Alors voilà : "Lloc"en catalan, c'est un mot tout ce qu'il y a de courant et banal ; ça veut dire "lieu" ; normalement, ça s'écrit avec un "c", cependant, on le trouve aussi parfois avec un "q". Mon prénom non plus n'est pas extraordinaire ; ma mère m'a dit que c'est en pensant à la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald qu'elle m'a baptisée ainsi.
Oui, mais en français, quand tu dis mon prénom et que tu épelles mon nom à suivre, ça fait "elle a deux ailes aux cul", et là tout le monde est plié. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, enfin, j'habite pas en France non plus, heureusement pour moi.
Allez, ciao tutti. Mon fumeur de havanes m'attend (eh oui, j'ai fini par en dégotter un !). C'est mon anniversaire aujourd'hui : j'ai vingt ans. Apéro, resto, casino. Radada, je sais pas ; des fois, il s'endort à mi-chemin. Je l'ai pris un peu trop vieux. Dans les cinquante balais. Ça m'apprendra, pour le prochain.
Enfin, il est gentil. Et je ne manque de rien. La semaine prochaine, je commence le tournage de "Attache-moi", avec Pedro. Les films qu'il réalise, on les croirait écrits pour moi. Dommage que je n'aie pas le premier rôle. Mais un jour viendra, vous verrez...
Je viens de me relire. Je crois que question style, je n'ai pas trop su tenir la distance. Cependant, au total, tout ça, c'est moi. Alors, je ne change rien.
©Pierre-Alain GASSE, mai 2010.
* picaresque : https://www.numilog.com/package/extraits_pdf/e235511.pdf
* marché de gros de Barcelone. L'équivalent de Rungis, quoi, pour la Catalogne.
* Maire socialiste de Madrid de 1979 à 1986.
*Tube d'Alaska et Dinarama de 1986. Traduction en vers de mirliton :"Entre mauvais et bon/pour moi plus de salut/Entre vice et vertu/je me trouve perdue/Hélas, ma perdition/sera sans rémission".
Vous êtes le
ième lecteur de cette nouvelle depuis le 15/06/2010. Merci.
| Laisser un commentaire à l'auteur | Télécharger en PDF |
 |