

Pierre-Alain Gasse d'après un cliché d'Alfredo Estrella©2006
Pour Florence C.
Avertissement
Ceci est une fiction, située quelque part en Amérique Latine. Les points de ressemblance avec telle ou telle affaire ne sont certes pas fortuits, mais limités.
I
Avec l'écharde arrachée au châlit de ma paillasse, dans la demi-clarté du jour qui se lève, je grave dans la chaux du mur la marque de fin de ma cent cinquante-sixième semaine d'enfermement.
Cent cinquante-six carrés de cinq centimètres avec leurs diagonales et un point central pour signaler chaque dimanche. À hauteur du regard, cela compose une sorte de frise qui court tout autour de ma cellule, depuis la porte d'entrée jusque de l'autre côté de la haute fenêtre munie de barreaux d'où tombe le jour.
Depuis tout ce temps, c'est en vain que j'essayais de ne pas penser aux quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze semaines que représenteraient les quatre-vingt-seize années d'emprisonnement auxquelles j'ai été condamnée en première instance.
Je n'ai pu m'empêcher de calculer que ma frise ferait alors dix-sept fois le tour de ma cellule et aurait une largeur de près de quatre-vingt-cinq centimètres. Ridicule. Pour le voir, il aurait fallu que je devienne la doyenne de l'humanité. Dans les conditions où je vis, c'est très improbable.
Et voilà qu'en appel, ma peine a été ramenée à soixante ans d'emprisonnement. Je reviens du parloir où mon avocat m'a annoncé le délibéré. Après les cent cinquante-six déjà écoulées, il me resterait donc encore... deux mille neuf cent soixante-quatre semaines à pourrir ici et autant de petits carrés à graver sur les murs. Soit près de dix fois le tour ma cellule. En sortant, j'aurais... quatre-vingt-quinze ans !
Autant mourir tout de suite !
Je songe à Marcos Ana, alerte octogénaire, en dépit de vingt-deux ans passés dans les geôles franquistes. À Nelson Mandela, emprisonné durant vingt-huit années dans son pénitencier de Robben Island... et à sa formidable résurrection. Je calcule qu'il aura bientôt quatre-vingt-onze ans, si j'ai bonne mémoire. Aucun des deux ne connaissait le terme de sa peine. Mais le monde au dehors a changé et un jour leur prison s'est ouverte. Pourquoi pas pour moi ? Une parcelle d'espoir m'anime l'espace d'un instant.
Mais comment ai-je l'audace de me comparer à ces deux êtres d'exception, moi, pauvre fille de France, au secret à des milliers de kilomètres de mon pays ? Je retombe dans la nuit sans fin de ma prison.
Je pense qu'ils avaient un point commun d'importance : des convictions affirmées auxquelles rien ne les aurait fait renoncer. Le communisme et l'antifranquisme pour l'un, la lutte pour la fin de l'apartheid et l'égalité raciale pour l'autre. Moi, qui n'ai ni ces idées ni leur force d'âme, comment vais-je survivre ? Au bout de trois petites années, me voilà démolie, chancelante, prête à sombrer dans le néant, le corps en capilotade et la tête en déroute.
Pour tenter d'apprivoiser ce temps qui n'en finit pas de passer, pour la énième fois, je reconstruis le film des événements qui m'ont amenée dans ce cul de basse-fosse. Je n'y vois que naïveté, malchance et maladresses.
II
Tout me plaisait dans ce pays, la langue, la chaleur, les gens, la cuisine... et j'avais décidé de m'y installer, après d'autres membres de ma famille. Un soir, dans l'établissement où je travaillais comme serveuse, j'ai rencontré Ángel. Je n'avais pour moi qu'un physique agréable et mon petit accent français. Lui menait grand train, vêtements et voitures de luxe, grands restaurants, propriété de rêve. Miroir aux alouettes. Il m'a draguée. Je me suis laissée séduire. Nous nous entendions bien, en dépit de son côté macho (quel mâle ne l'est pas un peu dans ce pays ?). Il brassait des affaires, m'avait-il dit, et je n'avais pas cherché à savoir lesquelles. Il me suffisait qu'il ait de l'argent pour deux. Je dois dire que nos rencontres étaient celles de deux amants : des corps à corps ardents suivis de sommeils réparateurs. Quatre mois d'aveuglement. L'aimais-je ? Je le pensais.
Je l'ai cru sincèrement attaché à moi. Il m'appelait tout le temps, m'offrait des fleurs, des bijoux. Il voulait que je cesse de travailler pour m'installer dans son ranch à cinquante kilomètres de la capitale. Moi, fille de la ville, m'enterrer à la campagne, même dans une villa de rêve, cela ne me tentait pas trop, surtout quand on connaît les embouteillages quotidiens aux entrées et sorties de cette métropole ! J'ai pourtant accepté d'aller passer quelques jours dans son paradis fermier. Deuxième erreur.
C'est comme cela qu'il y a trois ans, j'ai débarqué d'un hummer aux vitres fumées, dans une villa digne de la Californie, posée au milieu de centaines d'hectares d'orangers et d'oliviers. Piscines, sauna, jacuzzi, marbre, mobilier contemporain, pièces immenses, mais aussi grillages électrifiés, miradors et patrouilles à cheval. Cela aurait dû me faire réfléchir. Je n'y ai vu que des mesures de protection bien naturelles pour garantir une fortune des envieux. J'étais dans la nasse.
J'ignorais que lui et ses amis étaient sous surveillance, depuis longtemps déjà. Un matin, au petit jour, les brigades spéciales ont investi le ranch. Presque toute la bande est tombée. Et moi des nues. Mon hidalgo un racketteur ! J'ai d'abord refusé de le croire. Et puis, toute une foule de petits détails a commencé à s'organiser dans ma tête : des armes entrevues (mais ici la tradition veut qu'on soit armé), des bribes de conversations téléphoniques surprises, des réponses évasives, des jours de tension extrême suivis de réjouissances sans limites...
Alors, je suis entrée en rage. S'il avait été devant moi, je l'aurais étripé. Rage contre lui et rage contre moi aussi. De m'être laissée manipuler comme une collégienne. Mais il y avait plus urgent que mes états d'âme. La politique s'en est mêlée. Pour redorer son blason terni, un ministre en difficulté a voulu transformer notre discrète arrestation en triomphe médiatique.
C'est ainsi que le lendemain, dans un décor de carton-pâte, toutes les télévisions du pays ont pu filmer en direct une reconstitution de notre arrestation. Pas un écran où je ne sois apparue, menottes aux poignets, cheveux défaits, regard affolé. Pour le pays tout entier, je devenais le bouc-émissaire parfait : l'étrangère, celle par qui le mal arrive, l'âme damnée du groupe et, bientôt, l'instigatrice des enlèvements et du trafic.
Une instruction à sens unique, un procès perdu d'avance, en appel une victoire à la Pyrrhus, deux pays sans convention d'extradition et me voilà au fond du trou.
III
Soixante ans au lieu de quatre-vingt-seize, cela change quoi ?
Pour moi ce ne sont que deux nombres, proches de l'infini, mais cependant tous deux divisibles par deux, trois, quatre, six, dix, douze. Je me prends à rêver. Quatre-vingt-seize divisés par douze ? Huit ! L'arithmétique soudain se révèle à moi dans toute sa splendeur. Si seulement cela pouvait être vrai ! Soixante divisés par douze, cinq. Je trouve la différence insuffisante.
Mais hélas, pas le moindre diviseur à portée de main. Rien que ce cube dans lequel je ne tourne plus très rond déjà. Par moments, ma raison s'égare. Je vois des chiffres livrer bataille dans l'air raréfié de ma cellule et monter à l'assaut du jugement qui me tient enfermée ici.
Je reste prostrée, des heures durant, à calculer de tête le nombre d'heures, de minutes, de secondes que j'ai déjà passées dans ce trou à rats, à penser à tous ces possibles bonheurs perdus, gâchés, évanouis, envolés.
Voir le jour dissiper la nuit depuis le balcon de mon studio, humer la senteur d'une rose offerte, respirer l'arôme du café qui passe, vibrer aux notes d'un air de salsa. Me prélasser, cheveux épars, dans mon bain, interroger mon miroir, choisir ma tenue du jour.
Surveiller le temps qui fuit, m'habiller, me coiffer, me maquiller. Une touche de parfum. Choisir une paire de chaussures. Un dernier regard à la glace de l'entrée.
Fermer ma porte avec ma clé. Sortir dans la rue, me mêler à la foule qui va.
M'asseoir à la terrasse d'un café, jambes hauts croisées, guetter les regards qui se posent sur moi. Sentir alors mon pouls s'accélérer. Séduire, aimer. Vivre, enfin.
Au lieu de quoi, j'entends la matonne, en treillis et képi, dont le trousseau de clés sonne le glas de ma liberté à chaque pas de ses allées et venues dans le couloir. Soixante dans un sens, soixante dans l'autre et autant de cliquetis. À chaque temps d'arrêt pour manœuvrer un œilleton, j'arrête de compter. Puis, elle repart et je reprends mon calcul. Je redoute presque le moment où elle me fera perdre mon compte en ouvrant le guichet de ma cellule. Mais j'ai tout le temps de recommencer encore et encore, de comparer les infimes différences de rythme entre mes gardes-chiourme. Je divague.
Nous n'avons pas de miroir ici. Trop dangereux pour les veines. J'ignore à quoi je ressemble. La dernière image que j'ai de moi, c'est celle de mon arrestation retransmise par un écran de contrôle lors de cette reconstitution truquée. Pas très valorisante. J'ai essayé mentalement de remplacer cette image par une autre, des jours heureux de France, mais pas moyen, l'autre revient toujours se superposer à elle, la recouvrir jusqu'à totale disparition, et je pleure alors sur mes erreurs.
J'ai minci. La pitance est maigre pour ceux qui ne peuvent cantiner. Je sens mes côtes sous mes doigts. Mon pantalon de jogging menace de me tomber sur les chevilles. Cependant, je m'astreins tous les jours à un peu de gymnastique, le matin, après le café, quand le désespoir n'a pas encore mangé toute mon énergie.
Combien de temps cela peut-il durer ? Je veux dire, combien de temps puis-je tenir encore avant d'être aspirée comme la coque de noix que je suis dans le vortex de cet ouragan déchaîné contre moi ?
Si cette situation m'a d'abord donné l'obsession des chiffres et des nombres, c'est d'une réponse de mon avocat qu'est venue ma première et seule planche de salut. Alors qu'il partait et que, désespérée, je lui disais : "Comment tenir ?" il m'a répondu d'un seul mot : "Écrivez !"
C'est mon quotidien, à présent. Des chiffres et des lettres. Je ne sais où cela m'emmène. Je n'ai pas le droit de faire sortir ces écrits de prison et ces nombres ne veulent plus évacuer ma tête.
Mais si vous lisez ces lignes, c'est que mon avocat et moi avons réussi à déjouer la surveillance dont je suis l'objet.
Je vous en prie, répondez-moi ! Je reçois si peu de lettres. Et j'en ai tellement besoin.
Parlez-moi du dehors, de la pluie, du beau temps, des enfants qui jouent, de la mer qui roule, du vent dans les arbres, parlez-moi de l'amour, de la joie, du plaisir.
Parlez-moi de la vie. Ici, on se meurt.
Sans vos mots, comment voulez-vous voulez que je survive !
RETROUVEZ CE TEXTE
AINSI QUE 12 AUTRES NOUVELLES DANS
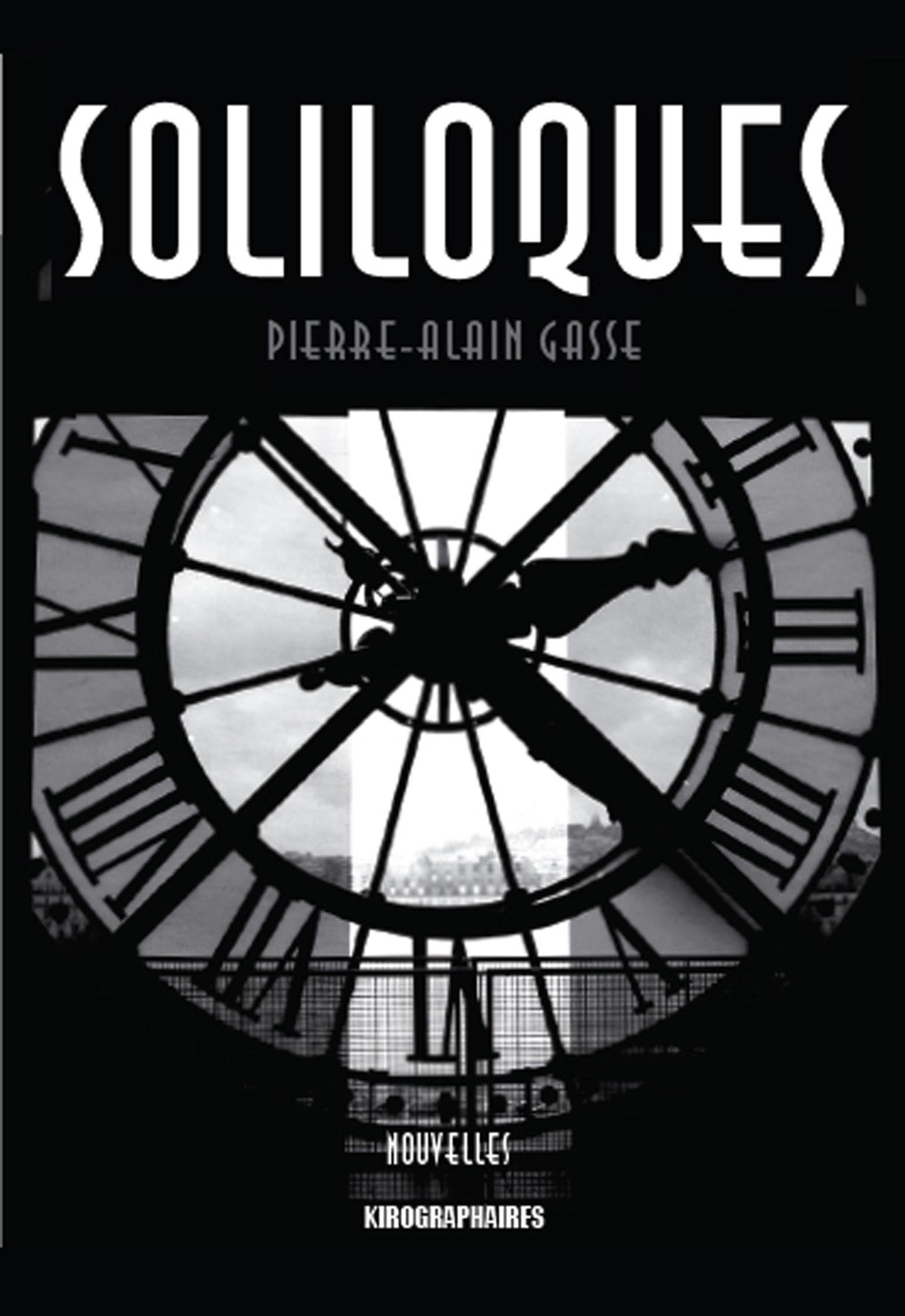
Disponible à la FNAC, Chapitre, Amazon, Dialogues, et chez l'auteur.
©Pierre-Alain GASSE, juin 2009.
Vous êtes le
ième lecteur de cette nouvelle depuis le 01/07/2009. Merci.
| Laisser un commentaire à l'auteur | Télécharger en PDF |

|