
Georges Brassens & Antoine Pol - Les Passantes

Son nom était Bienvenida
Jolie mulâtresse de Cuba,
Auto-stoppeuse de Jaca,
Étudiant je ne sais plus quoi.
Elle était sortie de ma mémoire ; du moins le croyais-je, avant que son prénom, retrouvé au bout d’une ligne, au détour d’une page d’un roman de Zoé Valdés, sa compatriote, ne me ramène à l’esprit notre brève rencontre, à l’image de la chanson de Michel Fugain que les radios matraquaient à tour de bras cette année-là : "Elle descendait vers le soleil... il remontait vers le brouillard...". Sauf que nous remontions tous les deux vers le nord, moi vers les bruines d’Armorique et elle, vers les merveilles parisiennes.
Je revenais d'un court séjour à Barcelone, pour rencontrer un écrivain autodidacte sur lequel mon rédacteur en chef m'avait demandé de faire un papier, à la suite du scandale qu'avait provoqué la sortie de son dernier livre, Donde la ciudad cambia su nombre, qui venait d'être traduit en français chez François Maspéro.
J’avais fait les mille trois cents kilomètres du voyage aller d’une traite, sans autre rencontre que celle d’un malandrin qui, dans Toulouse, était monté à l’improviste dans ma voiture, à un feu rouge et, sous la menace d’un couteau, m’avait soutiré les trois cents francs d’argent français qui me restaient !
Après deux heures perdues à porter plainte au Commissariat le plus proche, où l’on me reprocha presque de n’avoir pas su maîtriser mon agresseur, j’étais reparti, bien décidé à n’ouvrir mes portières, dorénavant fermées de l’intérieur, à personne, et c’est dans cet état d’esprit que j’avais repris l’autoroute A7 puis la Nationale II Barcelone-Saragosse, une semaine plus tard. Après une nuit de repos chez des amis de dix ans, j’étais reparti, toutes portières verrouillées, pour la seconde étape de mon périple de retour.
Seulement voilà, à la sortie de la ville-garnison de Jaca, endormie au pied des Pyrénées, m’attendait Bienvenida, assise sur son sac à dos, en plein soleil, le pouce indolemment levé. La visière de sa casquette maintenait dans l’ombre tout le haut de son visage mais sous la salopette de jean délavé, on reconnaissait sur le tee-shirt la célèbre effigie d’Ernesto "Che" Guevara, le médecin argentin, passé au service de la révolution cubaine, que sa mort suspecte dans les maquis boliviens avait transformé en héros planétaire de tous les rebelles d’après 1968. Au pied du sac, une pancarte indiquait simplement : Paris.
Alors, j’avais déverrouillé la portière du passager avant et laissé approcher cette jolie silhouette.
— Hola, ¿me puedes llevar?
— Bonjour. Vous pouvez m’emmener ?
J’avais vingt-six ans, autrement dit quelques années seulement de plus qu’elle. Et le tutoiement, si familier aux hispanophones, lui était venu naturellement. Mais sa traduction française dénoterait une familiarité de mauvais aloi, presque vulgaire, alors qu’en espagnol, il n’en est rien, enfin, en la circonstance, il n’en était rien.
— Claro, pero no voy a París. Hasta Burdeos si quiere, no hay problema.
— Bien sûr, mais je ne vais pas à Paris. Jusqu’à Bordeaux, si vous voulez, pas de problème.
Franchement, quel besoin avais-je de lui dire cela maintenant, au risque qu’elle me réponde : "dans ce cas désolé, je vais attendre une autre voiture. ?" En plus, moi, avec ma timidité habituelle, c’était la distanciation du vouvoiement qui m’était sortie de la bouche, et je le regrettais déjà. Quel imbécile, je faisais, décidément !
— Vale. Muchas gracias.
— D’accord. Merci beaucoup.
Sa réponse, à présent plus formelle, intégrait ma réserve : plus de tutoiement, mais un impératif passe-partout, impersonnel à souhait.
Et comment aurais-je pu faire marche arrière à présent, ainsi, tout à trac ? J’étais bien obligé de continuer dans la voie tracée, dans l’attente d’une occasion favorable pour retrouver la proximité qu’elle m’avait proposée d’emblée.
— Bueno, suba. Puede poner la mochila en el asiento trasero.
— Bien, montez. Vous pouvez mettre votre sac à dos sur la banquette arrière.
Il était évident que le plus intimidé des deux, c’était moi. J’avais beau tourner ma langue dans tous les sens en quête d’une phrase pour renouer le dialogue, rien ne sortait. Pas le moindre son. J’étais encore sous le choc. Qu’une belle inconnue monte ainsi dans ma voiture et m’offre sa compagnie pour plusieurs heures, voilà qui était inespéré. D’ordinaire, les seuls auto-stoppeurs que je ramassais c’était des militaires ou des étudiants boutonneux. Et quand une fille levait le pouce sur le bord de la route, je conduisais toujours la voiture qui suivait celle où elle montait !
De loin, je l’avais cru française, remontant vers la capitale, puis espagnole lorsqu’elle m’avait abordé en castillan, mais je fus soufflé lorsqu’elle me tendit soudain la main en disant :
— Me llamo Bienvenida. Soy una cubana de Miami, de viaje por Europa. ¿ Y usted ?
— Je m’appelle Bienvenida. Je suis une cubaine de Miami, en voyage en Europe. Et vous ?
— Pues bienvenida, Bienvenida. Yo soy Pedro, francés y catedrático.
— Eh bien, bienvenue, Bienvenue, Moi, c’est Pierre. Je suis français et professeur.
Avoir réussi ce jeu de mots téléphoné n’était pas glorieux et on avait dû le lui faire cent fois, mais au moins savait-elle que je n’étais pas idiot. Un sourire cordial éclaira son visage de métisse sous la visière rouge de sa casquette Coca-Cola. Le Che sur le coeur, et Coca-Cola sur le couvre-chef : le personnage s’annonçait complexe, provocateur ou irresponsable ! A moins qu’il ne soit le produit des deux cultures : la révolution cubaine côté cœur, le capitalisme américain côté tête.
— Lo siento, pero no hablo francés, sólo inglés y español, pero usted lo habla muy bien, ¿es de origen hispánico también?
— Désolé, mais je ne parle pas français, seulement anglais et espagnol, mais vous le parlez très bien, vous êtes d’origine hispanique vous aussi ?
— No, pero soy catedrático de lengua y literatura española.
— Non, mais j’enseigne la langue et la littérature espagnole.
— ¡Ah bueno! Pues, parece como si lo fuera, de verdad.
— Ah bon ! Eh bien, on s’y méprendrait, vraiment.
— Merci beaucoup.
— Ça, je comprends et aussi quelque autre petite chose. Bonjour..., comment ça va..., tout ça...
Evidemment, je ne pus éviter de lui sortir quelques platitudes, du genre : mais, c’est déjà très bien, et votre accent en français est très joli, alors que c’était un mélange assez surprenant entre l’accent appuyé des texans et celui, plus chantant, des sud-américains. Mais j’enchaînai bientôt en espagnol, notre commun dénominateur :
— Y ¿qué estudias, allá en Miami?
— Et tu fais quoi comme études, là-bas à Miami ?
Comme vous le voyez, j’avais réussi à renouer le dialogue sur le mode familier, presque sans m’en rendre compte, la sympathie aidant, sans doute.
— Sigo la carrera de arquitecto. Mi padre era uno allá, en Santiago de Cuba, pero mi madre es americana y después del embargo del año 60, fuimos declarados "personae non gratae" y tuvimos que irnos.Yo, entonces, era muy pequeña todavía, pero me acuerdo muy bien de nuestra casa colonial, de su baranda, de sus ventiladores de aspas indolentas, de sus postigos azules desteñidos...
—Je fais des études d’architecte. C’est ce qu’était mon père là-bas, à Santiago de Cuba, mais ma mère est américaine, et après l’embargo de 1960, nous avons été déclarés indésirables et avons dû partir. J’étais encore toute petite à l’époque, mais je me souviens très bien de notre maison coloniale, de la terrasse couverte qui l’entourait, de ses ventilateurs aux pales indolentes, de ses volets d’un bleu délavé...
— Y ¿ qué hace tu padre ahora ?
— Et que fait ton père à présent ?
— Mi padre ha muerto hace dos años, de pura pena. Y mi madre ha vuelto a su antiguo oficio de profesora.
— Mon père est mort, il y a deux ans, à force de chagrin. Et ma mère a repris son ancien métier de professeur.
— Disculpa. ¿ Así que estás sola con ella ?
— Excuse-moi. Alors, tu es seule avec ta mère ?
— No, tengo un hermano mayor de veintisiete que vive con nosotros. Es jugador de béisbol profesional en el equipo de Miami.
— Non, j’ai un frère aîné, de vingt-sept ans, qui vit avec nous. Il est joueur professionnel de base-ball dans l’équipe de Miami.
Après avoir laissé derrière nous l’imposant édifice Second Empire de la gare internationale de Canfranc, nous venions de dépasser la station d’altitude de Candanchu aux sommets encore enneigés, et ma Renault 16 attaquait, d’un ronronnement régulier, la montée des derniers lacets du versant espagnol du col du Somport. J’expliquai à ma voyageuse qu’avec ses 1632 m d’altitude, c’était le seul col des Pyrénées centrales ouvert toute l’année et qu’il avait vu passer les légions romaines de Pompée, puis les hordes sarrasines que Charles Martel devait arrêter à Poitiers, et aussi des milliers de pèlerins de toute l’Europe du Nord en route vers Saint-Jacques de Compostelle. Renseignements que je venais de lire dans mon guide Michelin, tandis qu’on me refaisait le plein à Candanchu tout à l’heure (on brille comme on peut !). Dernière station avant la frontière. La différence de prix n’était pas à négliger. Quelques centaines de mètres avant les barrières de la douane, Bienvenida avait sorti son passeport, pour le cas où, mais le militaire espagnol, assis dans sa guérite, sans prêter attention aux documents que nous lui tendions, nous fit signe d’avancer, d’un geste las. Le franquisme vivait sans le savoir ses dernières années, mais, depuis longtemps déjà, le contrôle aux frontières n’était plus ce qu’il avait été. La manne touristique avait adouci les mœurs.
Le versant français, plus vert, plus abrupt, au ciel plus couvert aussi, nous attendait. Près de trente kilomètres de virages et d’épingles à cheveux sous les frondaisons d’une route étroite jusqu’à Bedous, où, depuis quelques années, s’étaient installées les douanes françaises, pour mieux gérer les files d’attente qui, auparavant, paralysaient le col au plus fort des mois de juillet et d’août.
Oloron-Ste-Marie. Pau. Aire-sur-Adour. A l’entrée dans les Landes, la route se fit plus monotone, et la conversation, qui jusque là avait roulé sans encombre d’un sujet à l’autre commença aussi à se languir. Le soleil de cet après-midi de printemps nous assoupissait, malgré l’autoradio qui déversait en sourdine des variétés pas très variées. Les signes avant-coureurs de l’endormissement me donnèrent l’alerte :
— Me está entrando cansancio. Tengo que descabezar un sueño. Voy a pararme media hora, si no te molesta.
— Je commence à être fatigué. Il faut que je dorme un peu. Je vais m’arrêter une demi-heure, si ça ne t’ennuie pas.
Je bifurquai dans le premier chemin forestier un peu ombragé, et stoppai assez près de la route pour ne pas inquiéter Bienvenida, qui manifestait néanmoins une certaine tension. Je reculai mon siège et le mis en position inclinée et j’invitai ma passagère à en faire autant si elle le souhaitait, mais non, elle ne le souhaitait pas. Mains jointes entre ses genoux serrés, elle était sur le qui-vive. Il fallait la rassurer :
— Descuida. No te va a pasar nada. Descabezo un sueñecito y seguimos el camino. ¿ Vale ?
— Ne t’en fais pas. Il ne va rien t’arriver. Je fais un somme et on repart. D’accord ?
— Vale.
Malgré la somnolence d’après-déjeuner, je crois que nous ne dormîmes ni l’un ni l’autre, Bienvenida guettant un geste déplacé de ma part, et moi attendant d’elle le moindre signal qui m’eût autorisé un début de privauté. Cela n’eut pas lieu. Moi, j’avais promis, et elle ne me devait rien, ou si peu. En dépit de notre silence respectif sur notre situation sentimentale, révélateur d’une entrée tacite dans le jeu de la séduction, nos attaches personnelles à l’un comme à l’autre furent les plus fortes. Et pourtant, j’en suis convaincu, il aurait suffi d’une étincelle pour que d’une attirance physique certaine naisse une aventure de vacances. Mais le souvenir qu’une relation trop brève nous eût laissé aurait-il été plus beau que celui que je raconte aujourd’hui ? Un moment de plaisir contre des années de remords, peut-être. Je ne connaîtrai jamais la réponse à cette question.
C’est toujours avec un petit pincement au cœur que je repasse, de temps à autre, sur la route de l’Espagne, devant cette allée forestière que nous quittâmes une demi-heure plus tard, sans même que je lui aie pris la main.
Nous roulâmes tout le reste de l’après-midi. Et j’ai perdu le souvenir exact de nos propos. Je ne suis d’ordinaire guère bavard, quand je suis au volant. Mais, Bienvenida, désormais davantage portée à me faire confiance, retrouva sa spontanéité latine et assura l’essentiel de la conversation. Je me souviens quand même qu’elle compara les mérites du pont d’Atlantique, à Bordeaux, avec ceux du Golden Gate de San Francisco !
A Saint-André de Cubzac et son écheveau d’itinéraires, nos routes auraient dû se séparer, mais nous ne nous y résolûmes ni l’un ni l’autre, et lorsque je proposai à Bienvenida de faire un crochet pour l’emmener jusqu’à Poitiers, elle accepta tout de suite.
Il était tard déjà, lorsque nous nous arrêtâmes pour dîner dans cet hôtel-restaurant routier quasi-désert de Saint-Pierre-des Corps. Une salle toute en longueur et un serveur qui s’impatientait alors que je traduisais à grand-peine à Bienvenida les propositions du menu du jour. La nourriture française était une telle découverte pour elle ! Aussi loin des hot-dogs de Miami que des "tortillas" et des "frijoles" de son île natale.
Comme dans tous les restaurants de routiers, le menu du jour était roboratif à souhait : assiette de crudités et charcuterie, boeuf miroton, salade, plateau de fromages, tarte maison et un litre de vin rouge par table de deux.
Nous avons mangé machinalement, mentalement préoccupés par toute autre chose que la nourriture qu’il y avait dans nos assiettes.
Je dis à Bienvenida que la route était encore longue pour elle comme pour moi, et que j’envisageais de faire étape ici. Le patron me confirma qu’il lui restait des chambres. C’était une invite cousue de fil blanc. Et Bienvenida le comprit si bien qu’elle ne répondit pas tout de suite. Tout en échangeant des banalités, nous mangeâmes le dessert et bûmes un café. C’est alors qu’elle dit enfin :
— Prefiero seguir hasta París hoy mismo. Voy a tomar un tren de noche. Me puedes acercar hasta la estación ?
— Je préfère aller jusqu’à Paris aujourd’hui même. Je vais prendre un train de nuit. Tu peux m’emmener jusqu’à la gare ?
Je pensai que peut-être l’argent lui faisait défaut :
— No te vayas por el dinero, que te invito yo.
— Si c’est pour l’argent, ne t’en fais pas, tu es mon invitée.
— Lo siento, Pedro, pero es mejor que me vaya, y lo sabes.
— Je regrette, Pierre, mais il vaut mieux que je m’en aille, et tu le sais.
— Bueno, maja, me da pena, pero ¿ qué le puedo hacer ?
— Cela me désole, tu sais, mais que puis-je y faire ?
Nous échangeâmes nos adresses sur des coins de calepin, et dix minutes plus tard, je la laissais dans un hall de gare vide. Le baiser sur les joues que nous échangeâmes fut le seul contact physique que nous eûmes, et dans notre regard, on aurait pu lire tout le regret que nous avions de nous quitter ainsi, suivant la voie de la raison.
Finalement, je ne pris pas de chambre. Et lorsqu’après avoir roulé toute la nuit, je regagnai mon appartement de Saint-Malo, à ma compagne qui m’interrogeait sur le déroulement de mon voyage, je répondis :
— A l’aller, j’ai perdu deux heures à Toulouse, après avoir été rançonné à un feu rouge par un type avec un couteau, mais au retour, rien à signaler. J’ai hésité à faire étape à Poitiers, hier soir, mais finalement j’ai préféré rentrer directement.
(Préférer n’était sans doute pas le terme adéquat, mais il y a des vérités qui ne sont jamais bonnes à dire pour la paix des ménages.)
Adieu, ma jolie passante !
©Pierre-Alain GASSE, aaoût 1999. Tous droits réservés.
RETROUVEZ CE TEXTE
AINSI QUE 12 AUTRES NOUVELLES DANS
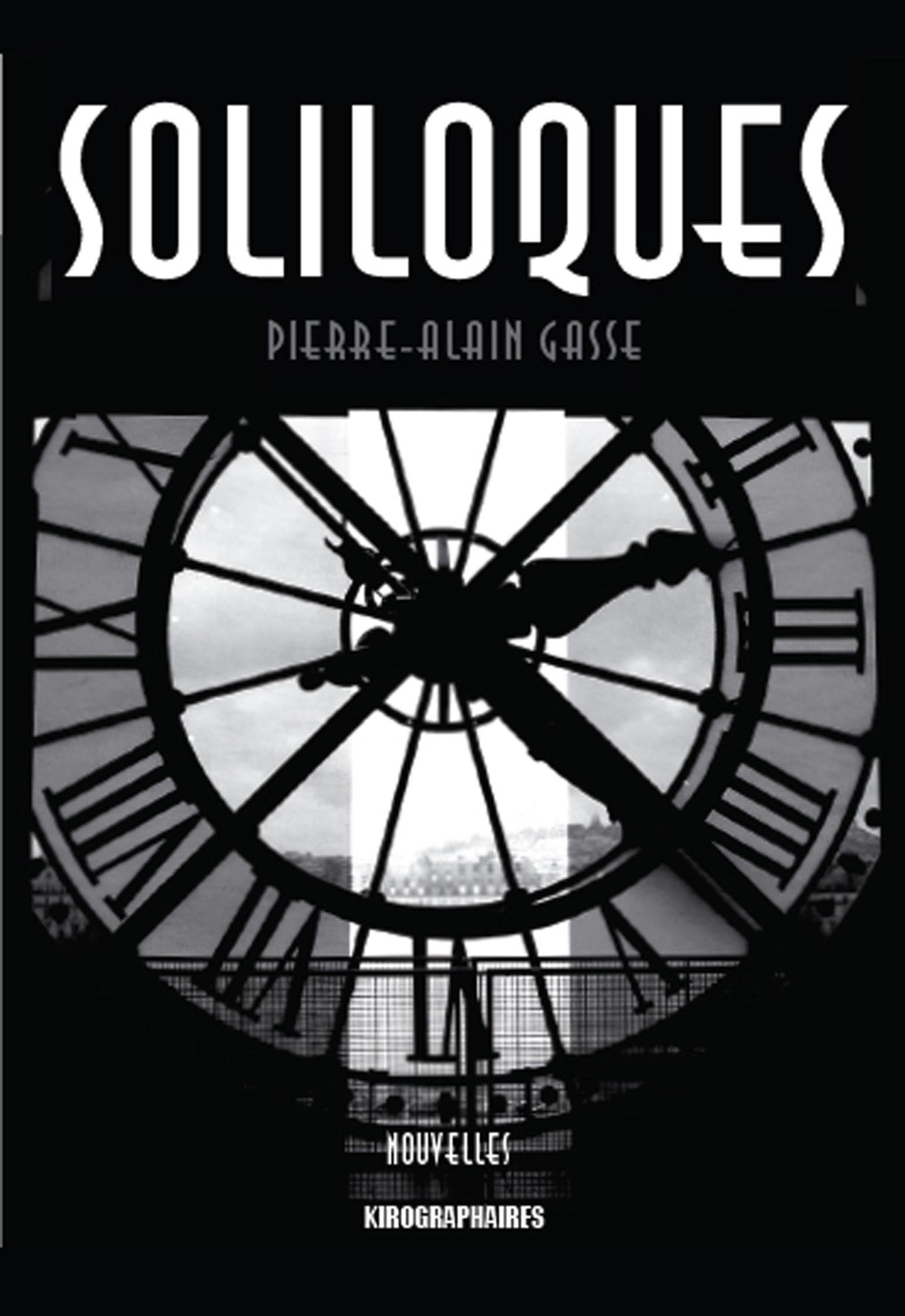
Disponible à la FNAC, Chapitre, Amazon, Dialogues, et chez l'auteur.
Vous êtes le ième lecteur de cette nouvelle depuis le 28/05/2000. Merci.
| Laisser un commentaire à l'auteur | Télécharger en PDF |
 |